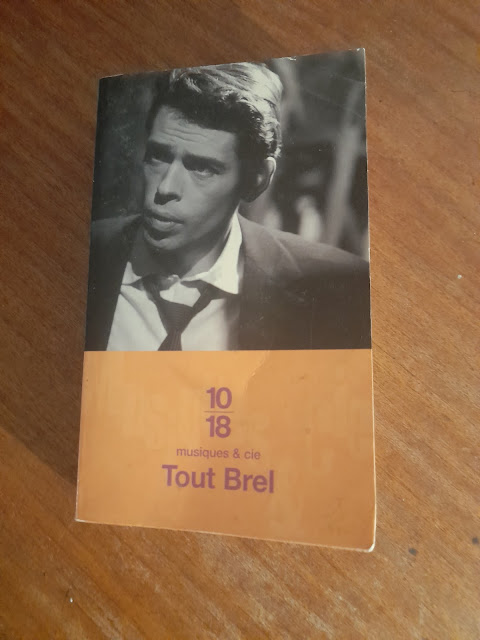« Paris change !
mais rien dans ma mélancolie
N’a bougé ! palais neufs,
échafaudages, blocs,
Vieux faubourgs, tout
pour moi devient allégorie,
Et mes chers souvenirs
sont plus lourds que des rocs.»
Charles Baudelaire
Le
nouveau livre de Marie-Anne Bruch, Excursions poétiques, semble
s’inscrire dans une tradition clairement identifiée, presque un genre
littéraire en soi : l’errance parisienne.
Inauguré
sans doute par les personnages de Balzac, Baudelaire, qui plus qu’un autre a mis
Paris sur la carte du monde poétique. Poursuivi au vingtième siècle par Rilke, Céline,
Aragon, les dérives situationnistes, jusqu’aux déambulations somnambuliques des
personnages de Modiano.
Hélas,
si on peut dire, Marie-Anne Bruch nous décrit le Paris des années 2020 et le
tableau est très ressemblant. Ce qui domine, c’est le mouvement perpétuel, le
grouillement presque insensé et le bruit… Pour la plaisanterie, le vieux
Voltaire se plaignait déjà, au dix-huitième siècle, que Paris fût une ville si populeuse
et bruyante !
Marie-Anne
Bruch au fil des textes courts qui composent Excursions poétiques, traduit
bien l’épaisseur de son dans laquelle l’individu contemporain flotte
sans en avoir conscience. Une douce musique vous accompagne toujours, ainsi que
les bruits ordinaires, assourdissants, du « trafic automobile »,
du « métro aérien » et des travaux publics. Chansons pop,
rythmes techno, airs de bossa vous invitent à penser que vous vivez dans le
meilleur des mondes ! Ce bruit continuel, ininterrompu enveloppe une
grande laideur publicitaire aux couleurs criardes. Celle du tourisme
international… Tout le monde se presse à Paris, pour y déambuler sans rien
voir.
Marie-Anne
Bruch au contraire fait figure de passante « contemplative »,
qui s’attarde et regarde, quitte à passer pour une personne un peu louche aux
yeux de ses contemporains plus pressés. Elle le répète à plusieurs reprises.
Ce
qui est très intéressant, outre l’envahissement de l’espace public par le
téléphone portable, signe des temps et changement presque anthropologique comme
diraient les pédants, c’est que les véritables parisiens, ceux qui habitent
Paris, ont l’air sous la plume de Marie-Anne Bruch, bien « fatigués »,
mornes, déprimés, une masse aveugle qui ne croit plus depuis longtemps à la
fête obligatoire… D’ailleurs, même les touristes ont l’air de se demander ce
qu’ils font là :
« Il
est possible que cette place soit dédiée à la gaîté mais le visage des passants
n’a rien de réjouissant, qu’ils farfouillent au fond de leur porte-monnaie
dépressif, qu’ils soient affublés d’écouteurs rutilants, de sacs à dos obèses
ou qu’ils fassent rouler leurs valises d’une main malhabile. Tous ces candidats
au voyage et autres tireurs de bagages paraissent à la fois sur le départ, sur
le retour et sur le point de ne pas y arriver. Devant la terrasse où je me
trouve se dresse un kiosque à journaux, où des cartes postales panoramiques et
diverses babioles et colifichets pour touristes étrangers – grands amateurs de
Tour Eiffel – brillent en vain. »
Ceci
dit, passée cette impression de détachement ironique face à la comédie débraillée
du monde, on comprend que cette errance à travers différents lieux de Paris a
une importance existentielle pour l’auteur… Se laissant emporter par « le torrent
de la mémoire », l’auteur est à la recherche d’elle-même et les lieux
où Marie-Anne Bruch retourne ne sont pas indifférents : ce sont
ceux de son enfance, de son adolescence tourmentée, de ses premières amours, de
ses démarches infructueuses dans le monde professionnel. Il y a même des
endroits de Paris où elle se force à aller pour se confirmer qu’elle avait bien
raison de les détester. Déjà à l’époque !
C’est
l’heure des bilans, et ils ne sont pas tous négatifs, loin de là… Même si l’auteur doit bien constater que sa
ville, Paris, est devenue quelque chose qu’elle ne comprend plus vraiment, qu’elle-même
a changé, que du seul fait de son âge et de son vécu elle se sent un peu étrangère au monde
qui l’entoure, elle reste fidèle à certains de ses refus et à son goût
pour la beauté, d’une architecture ou d’un jardin.
Frédéric
Perrot
Marie-Anne Bruch, Excursions poétiques
Z4 éditions