Un cauchemar parisien
« La
rue était trop vide et s’ennuyait de ce vide ; elle déroba mes pas de sous mes pieds et les fit sonner de droite et
de gauche, d’un côté à l’autre de la rue, comme avec un sabot. La femme eut
peur et elle se détacha d’elle-même, trop vite, trop violemment, tant et si
bien que son visage resta dans ses deux mains. Je pouvais le voir couché là, je voyais sa forme en creux. Je fis un immense effort pour ne pas
détourner mon regard de ces mains et pour ne pas voir ce qui s’était arraché
d’elles. J’étais terrifié de voir un
visage par l’intérieur, mais je redoutais cependant bien davantage d’apercevoir
la tête nue, écorchée, dépourvue de visage. »
Malte Laurids Brigge, le double fictif de
Rilke, vit et écrit dans une épouvantable angoisse en partie générée par la
ville où, jeune étranger, il vient de s’installer et qu’il n’aime pas – Paris –
et où, à tout instant, il est confronté à la plus noire des misères, où tout le
blesse, la purulence des corps, la dégoûtante saleté, la ruine et la
décomposition.
À un moment, il trouve au sens propre refuge à la Bibliothèque nationale, dans
laquelle l’horrible pauvreté qui le hante ne peut pénétrer et le suivre. Selon
le préfacier du Livre de la Pauvreté et
de la Mort, Rilke, qui n’aimait pas les grandes villes en général, a été
« traumatisé » par sa
découverte de Paris.
« J’ai
peur. Il faut faire quelque chose
contre la peur, quand on l’a. » La peur revient, toujours : « Toutes les peurs oubliées sont à nouveau là.
» Ces « peurs oubliées »
sont celles de l’enfance.
L’adulte a peur de devenir fou :
« … la peur que je me mette à crier
et qu’on accoure à ma porte et qu’on finisse par la forcer, la peur que je
puisse me trahir et raconter tout ce dont j’ai peur et la peur que je ne puisse
rien dire, parce que tout est indicible »
S’ensuit cette conclusion amère :
« J’avais prié pour retrouver mon
enfance et elle est revenue et je sens qu’elle est aussi lourde à porter
qu’autrefois et que cela ne m’a servi à rien de vieillir. »
« …
la splendeur n’est que d’un instant, et
nous n’avons rien vu dont la vie soit plus longue que la misère. »
… les pages extraordinaires sur cet enfer
de crasse et de misère qu’est Paris, sous la plume de Rilke. Il y a ainsi pour
la crasse la longue description de la maison en ruines dont on voit « le dedans » : « On voyait aux différents étages des parois
où des tentures étaient restées collées, çà et là le commencement d’un plancher
ou d’un plafond. À côté des cloisons
des chambres, on voyait aussi tout au long du mur un espace d’un blanc sale, au
milieu duquel rampait, d’une manière atrocement écœurante, qui évoquait le
mouvement mou d’un ver ou le trajet de quelque digestion, la descente crevée et
couverte de taches de rouille des cabinets. ».
La misère est non moins répugnante : « Que diable pouvait me vouloir cette vieille femme, sortie de je
ne sais quel trou, avec son tiroir de table de nuit, dans lequel roulaient
quelques boutons et quelques aiguilles ? Pourquoi restait-elle à côté de moi à m’observer ? Comme si elle essayait de me reconnaître
avec ses yeux chassieux, qui auraient pu faire croire que c’était un malade qui
avait craché ses glaires verdâtres sur ses paupières sanguinolentes.»
C’est bien l’enfer, ces rues sales, que
hantent des « réprouvés »
qui vous ont reconnu comme un des leurs et auxquels il s’agit d’échapper. C’est
bien l’enfer, mais dans sa version bureaucratique, que cet hôpital de la
Salpêtrière.
Dans une lettre de 1907 à sa femme, Rilke
compare son personnage au Raskolnikov de Crime
et châtiment. Malte Laurids Brigge serait un Raskolnikov sans le crime.
Mais tout y est : la pauvreté et la hantise de la misère, la révolte,
l’errance hallucinatoire.
L’atmosphère même des deux livres me
semble proche : la chaleur « étouffante »,
la puanteur. « La rue commençait de
toutes parts à sentir. Cela sentait,
dans la mesure où on pouvait le discerner l’iodoforme, la graisse de pommes
frites, la peur. Toutes les villes
sentent, l’été. »
Dans Le
Livre de la Pauvreté et de la Mort : « Ou bien est-ce l’angoisse où je suis enfoui, / la si profonde angoisse
des villes démesurées/où tu m’as enfoncé jusqu’à en suffoquer ? »
--------------------------------
La révolte de Malte s’énonce clairement
dans un passage célèbre, un des morceaux de bravoure du livre, porté par une
dialectique fiévreuse :
« C’est
ridicule. Me voilà dans ma petite
chambre, moi, Brigge, âgé de vingt-huit ans, que personne ne connaît. Je suis assis ici et je ne suis rien. Et pourtant, ce rien se met à
réfléchir ; il réfléchit dans
son cinquième étage, par un maussade après-midi parisien, et voici ce qu’il
pense :
Est-il
possible, pense-t-il, qu’on n’ait encore rien vu, rien su, rien dit qui soit
réel et important ? Est-il
possible qu’on ait eu des millénaires pour regarder, pour réfléchir, pour enregistrer
et qu’on ait laissé passer ces millénaires comme une récréation dans une école,
pendant laquelle on mange sa tartine et une pomme ?
Oui,
c’est possible. »
Cependant, « dans ce livre crispé par la peur et hanté par la mort », comme
l’écrit le traducteur et préfacier Claude David, une plus étrange obsession
habite le personnage et son créateur : « … le désir d’avoir sa propre mort est de plus en plus rare. Encore un
moment et ce deviendra aussi rare que d’avoir une vie qui vous soit propre.
« On meurt au petit bonheur ; on meurt de
la mort qui correspond à la maladie que l’on a ». Et : « Dans les sanatoriums, où l’on meurt si
volontiers et avec tant de reconnaissance à l’égard des médecins et des
infirmières, on meurt d’une des morts organisées par l’établissement ; c’est fort bien considéré. Mais, si l’on meurt chez soi, il est
naturel de choisir la mort décente de la bonne société, avec laquelle on
s’engage déjà pour ainsi dire dans l’enterrement de première classe et dans tous
les rites admirables qui l’accompagnent.
Les pauvres sont debout sur le seuil de la maison et admirent tout leur saoul. Leur mort à eux est naturellement banale,
sans aucune cérémonie. Ils sont bien
contents d’en trouver une qui leur aille à peu près. »
Selon Malte, il n’en a pas toujours été
ainsi : « On savait autrefois
(ou peut-être le pressentait-on) qu’on contenait la mort à l’intérieur de
soi-même, comme un fruit son noyau.». Et : « On possédait sa mort et cela conférait à chacun une singulière
dignité et une paisible fierté. »
Il s’agit d’avoir sa mort à soi, de
se soustraire à la mort impersonnelle, « en série, comme à l’usine », dont l’Hôtel-Dieu et l’hôpital de
la Salpêtrière sont à Paris les horribles symboles. Et, par opposition à cette
mort de « masse », se fait
jour une étonnante nostalgie d’une époque révolue et sans doute fantasmatique
où l’on savait mourir :
« Et quand je pense aux autres, à ceux que j’ai vus ou dont j’ai entendu
parler, c’est toujours la même chose. Ils
ont tous eu leur mort à eux. Ces
hommes, qui la portaient dans leur cuirasse, à l’intérieur, comme une captive,
ces femmes, qui devenaient très vieilles et toutes petites et qui ensuite,
étendues sur un immense lit comme sur une scène de théâtre, en présence de
toute la famille, de la domesticité et des chiens, passaient de vie à trépas,
discrètes et souveraines. Et les
enfants, même les tout-petits, ne mouraient pas d’une quelconque mort d’enfant,
ils se ressaisissaient et mouraient selon ce qu’ils étaient déjà et selon ce
qu’ils seraient devenus. »
Comme Raskolnikov, Malte est un
personnage qui échoue face à une « épreuve »
« plus forte que lui » et à
partir d’un certain moment, et c’est très beau, ce pauvre « rien » semble complètement se
détourner du monde réel ; il ne quitte plus « son cinquième étage » ; il passe ses jours et ses nuits,
enfoui dans ses lectures – principalement des ouvrages historiques – et
l’écriture.
------------------------------
Sur la possibilité du récit – « S’il fut une époque où l’on savait
raconter, vraiment raconter, ce doit avoir été avant mon temps. ». Et sur
sa méfiance « envers la musique (non
parce qu’elle me soulevait plus fort que tout hors de moi-même, mais parce que
j’avais remarqué qu’elle ne me déposait plus là où elle m’avait trouvé, mais
plus bas, quelque part dans l’inachevé) »
Sur la mort de Félix Arvers – « Il était poète et détestait
l’à-peu-près ; ou peut-être
n’était-il soucieux que de vérité ;
ou bien était-il fâché que la dernière impression qu’il emportait était qu’il y
eût dans le monde tant de négligence. »
Selon Claude David, « l’anecdote » « semble être tout imaginaire ».
Félix Arvers est ce poète que l’on connaît presque uniquement pour son Sonnet, mis en musique par Serge
Gainsbourg (« Ma vie a son secret, mon cœur a son mystère/Un amour éternel
en un moment conçu »)
Sur Verlaine – « Vous ne savez pas ce que c’est qu’un poète ? Verlaine… Rien ? Cela ne vous rappelle rien ? Non. Vous ne l’avez pas distingué des
autres que vous connaissiez ?
Vous ne faites pas de distinctions, je le sais bien. »
Sur Baudelaire – « Une prière de Baudelaire ; une
véritable prière toute simple, faite avec les mains, maladroite et belle comme
la prière d’un homme russe. Et il
avait un long chemin à faire pour en arriver là, Baudelaire, un chemin qu’il a
parcouru à genoux et en rampant. Qu’il
était loin de moi en toute chose, peu m’étaient plus étrangers que lui ; il m’arrive souvent d’avoir de la peine à
le comprendre et pourtant, quelquefois, quand, la nuit, je répétais ses paroles
comme un enfant, il était, comme aucun autre, mon prochain ; il était là, tout blême, derrière la mince
cloison et prêtait l’oreille à ma voix qui flanchait. Quelle étrange communauté s’établissait alors entre nous ; nous
partagions tout, la même pauvreté, peut-être la même peur. » (Lettre à
Lou Salomé, 18 juillet 1903)
Avant l’épisode décisif de la Salpêtrière,
où l’angoisse devient si intolérable que tout le livre bascule, Malte recopie
le dernier paragraphe du poème en prose de Baudelaire, « À une heure du
matin ».
« J’ai
là sous les yeux, dans ma propre écriture, ce que j’ai prié soir après soir. Je
l’ai copié dans les livres où je l’ai trouvé, pour l’avoir tout près de moi,
sorti de ma main comme si j’en étais l’auteur. »
Malte a lui-même écrit des vers et explique
pourquoi ils sont mauvais : « Hélas ! les vers signifient si peu de chose quand
on les écrit trop tôt. Il faudrait
attendre, accumuler toute une vie le sens et le nectar – une longue vie, si
possible – et seulement alors, tout à la fin, pourrait-on écrire dix lignes qui
soient bonnes. Car les vers ne sont
pas faits, comme les gens le croient, avec des sentiments (ceux-là, on ne les a que trop tôt) – ils sont faits d’expériences vécues. »
« Pour écrire un seul vers, il faut avoir vu beaucoup de villes, d’hommes
et de choses… »
« Il
faut avoir le souvenir de nombreuses nuits d’amour, dont aucune ne ressemble à
une autre… »
« Il
faut avoir été aussi au côté des mourants, il faut être resté au chevet d’un
mort, dans une chambre à la fenêtre ouverte, aux rares bruits saccadés. Et il n’est pas encore suffisant d’avoir des
souvenirs. Il faut pouvoir les
oublier, quand ils sont nombreux, et il faut avoir la grande patience
d’attendre qu’ils reviennent. Car les
souvenirs ne sont pas encore ce qu’il faut. »
À la Bibliothèque nationale – « Je suis assis et je lis un poète. Il y a
beaucoup de gens dans la salle, mais on ne sent pas leur présence. Ils sont plongés dans les livres. Ils bougent quelquefois entre les pages,
comme des rêveurs qui se retournent entre deux rêves. Ah ! qu’il fait bon
d’être au milieu de gens qui lisent ! Pourquoi ne sont-ils pas toujours ainsi ? Tu peux t’approcher de l’un d’eux et le toucher doucement, il ne
sentira rien. Et si tu bouscules un
peu ton voisin en te levant et que tu lui fais des excuses, il fait un signe de
tête du côté d’où vient la voix, il tourne son visage vers toi sans te voir et
ses cheveux sont semblables aux cheveux d’un dormeur. Comme cela est bon ! Et
je suis assis et j’ai un poète. Quel
destin ! Il peut y avoir dans la
salle trois cents personnes en train de lire ; mais il est impossible que
chacun d’entre eux ait un poète (Dieu
sait ce qu’ils peuvent lire !).
Il n’existe pas trois cents poètes. Mais
vois un peu mon destin ! moi, le
plus misérable peut-être de ces lecteurs, moi un étranger, j’ai un poète. Bien que je sois pauvre. Bien que mon costume, que je porte tous les
jours, commence à être élimé par endroits, bien que mes chaussures ne soient
pas à l’abri de la critique. »
Frédéric Perrot - février 2019
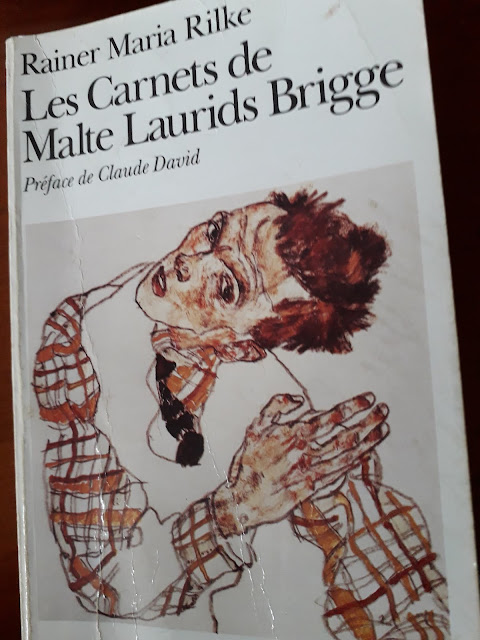
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire