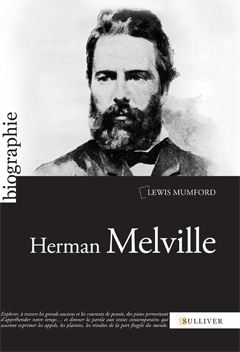Les deux rêves de
Raskolnikov – Pour lire Crime et châtiment
L’inconscient
n’est pas un théâtre où s’agitent de toute éternité Œdipe ou Hamlet ;
l’inconscient est une usine…
Gilles
Deleuze
Il est de multiples façons de présenter le
premier des « grands romans » de Dostoïevski : Crime et châtiment, écrit en 1866. C’est
à la fois un roman policier et un roman social ; un roman philosophique et
un roman « fantastique », comme le sont tous peu ou prou, par leurs étrangetés et leurs
invraisemblances, les romans de Dostoïevski. C’est non moins un roman
sentimental, voire mélodramatique que le roman d’une ville, Saint-Pétersbourg, poussiéreuse,
étouffante – le roman se déroule en été et commence « par une soirée extrêmement chaude du début de juillet » –, et qui
semble un décor de cauchemar ; Saint-Pétersbourg étant la plus « abstraite » des villes comme
l’écrit ailleurs l’auteur.
L’intrigue générale est connue : un
ancien étudiant excessivement pauvre, Raskolnikov, pour obéir à « une idée » conçue dans la solitude
et le dénuement, « une théorie »
douteuse et que l’on pourrait dire « préfasciste », décide de tuer
une « vile » usurière et de
la voler ; ce qui lui permettra idéalement de se lancer dans la vie.
L’auteur ne partage pas les illusions dangereuses de son personnage ; des
idées aux actes, il y a un abîme ; jamais on n’a vu un assassin aussi
maladroit et le meurtre tourne à la catastrophe. Raskolnikov, qui s’imaginait
être un de ces hommes « supérieurs »
au sujet desquels il a écrit un article pour y exposer sa fameuse théorie et pensait
qu’il pourrait donc tuer de sang-froid pour « la beauté du geste », ne
tire aucun bénéfice de son crime – il cache sous une pierre les quelques objets
qu’il est péniblement parvenu à dérober –, et devient rapidement par son
comportement bizarre, ses propos incohérents ou agressifs, son « délire » permanent – le personnage
est « fiévreux » et « malade » d’un bout à l’autre du
roman –, un coupable évident pour le malicieux et ironique magistrat chargé de
l’instruction.
Mais Crime
et châtiment n’est pas un roman qui se « résume » aussi
facilement ! Les personnages sont nombreux (il y en a fait une bonne
quinzaine de personnages importants pour l’histoire) et cette intrigue générale
se trouve compliquée par plusieurs autres intrigues secondaires, comme celle,
désolante, pathétique, de la famille Marmeladov ou celle du sinistre débauché
Svridigaïlov, cet homme « perdu de
vice » dont la figure semble annoncer celle de Stavroguine dans Les Possédés.
Oui, ce serait un euphémisme de dire que Crime et châtiment est un roman touffu, embrouillé et
labyrinthique ! C’est pour cette raison que je ne m’attarderai ici que sur
un point de détail, un élément en apparence sans importance de l’intrigue :
les deux rêves de Raskolnikov…
Le rêve du chapitre six et dernier de la troisième
partie (le second rêve) même s’il conclut un chapitre presque entièrement
onirique est un cauchemar « classique ».
Après l’avoir commis, Raskolnikov y revit
son crime ; mais tout se passe encore plus mal, si cela est possible. Ainsi,
la vieille usurière refuse de mourir sous ses coups de
hache : « on l’eût crue de
bois ». « Le vestibule » est « plein de monde » ; les témoins
« tête contre tête » sont
nombreux et hilares ; la vieille rit aussi horriblement ; une « rage » impuissante s’empare de
l’apprenti-meurtrier…
Un cauchemar, ai-je dit ; dont le
sens semble bien évident : culpabilité, impuissance, souffrance… On
comprend alors que Raskolonikov n’échappera plus à ce qu’il croyait orgueilleusement
pouvoir laisser derrière lui, les pièges qu’une conscience malheureuse se tend
à elle-même (1)…
Le premier rêve, dont le récit occupe une
bonne moitié du chapitre cinq de la première partie, est à mon sens beaucoup
plus significatif et important pour
le roman dans son ensemble.
Voici comme il est introduit par le
narrateur ; un narrateur qui est moins « envahissant » que dans
d’autres romans de Dostoïevski et dont les interventions sont relativement
rares :
« Les
songes d’un homme malade prennent souvent un relief extraordinaire et
rappellent la réalité à s’y méprendre. Le tableau qui se déroule ainsi est
parfois monstrueux, mais les décors où il évolue, tout le cours de la
représentation sont si vraisemblables, pleins de détails si imprévus, si
ingénieux et d’un choix si heureux, que le dormeur serait assurément incapable de les inventer à l’état de veille,
fût-il un artiste aussi grand que Pouchkine ou Tourgueniev. »
Que raconte ce rêve introduit d’une façon
aussi solennelle ?
Une scène d’enfance... Raskolnikov, tout
petit garçon, se promène en compagnie de son père et assiste au plus horrible
des spectacles. Un spectacle qui devait à l’époque, non moins que les accidents
de charrettes, la peur très légitime d’être renversé par un cheval puisque le
cheval est alors le principal moyen de transport et qu’il y en a à chaque coin
de rue, être fort fréquent, habituel, hélas presque quotidien ; n’en
déplaise à Freud dans son interprétation de la phobie du « petit
Hans » pour les chevaux.
Un groupe d’ignobles ivrognes, sous les
yeux de l’enfant, à peine sortis de leur lieu de débauche, un « cabaret » devant lequel traîne
« tout un ramassis d’individus
louches », se mettent par brutalité, bêtise, à martyriser un « petit cheval », une « pauvre haridelle » épuisée, jusqu’à
la faire mourir sous les coups… La scène est cruelle, interminable ; les
coups pleuvent sur « le museau »,
« les yeux » ; les
ivrognes en criant s’encouragent l’un l’autre et frappent avec tout ce qui leur
tombe sous la main ; l’enfant est en pleurs ; il voit tout et échappant à son père, tente de protéger le malheureux
animal…
C’est un rêve « traumatisant »
pourrait-on dire ; mais un rêve qui permet aussi de comprendre la révolte
de Raskolnikov. En effet, si l’enfant est choqué, bouleversé par l’horreur de
la scène, il l’est tout autant par l’absence de réaction de son père et les
réponses gênées que celui-ci donne à la question légitime qui serait celle de tout enfant : « Petit père, pourquoi ont-ils tué… le pauvre
petit cheval ? »
Et le père répond, comme tous les pères
sans doute, une première fois : « […] Allons-nous en, ne regarde pas… » ; puis « ce sont des ivrognes, ils s’amusent ;
ce n’est pas notre affaire, viens ! ». Ce « ne regarde pas » est vertigineux et
évidemment essentiel : il résume le mensonge éhonté des pères ; pour
qui il s’agit toujours de regarder
ailleurs ou parce que cela est plus sage et facile de fermer les yeux, sur tout ce que ce monde peut avoir de triste et
de déplorable…
D’un mot, la figure paternelle s’écroule
dans ce rêve… Mensonge, renoncement, petits accommodements avec le triste cours
des choses : ce n’est pas glorieux (2) ; et l’éternel « pourquoi » de l’enfant reste sans
réponse ; puisque à cet instant, évidemment Raskolnikov se réveille
« le corps moite, les cheveux
trempés de sueur, tout haletant » et en remerciant Dieu que tout cela
n’ait été « qu’un rêve ».
Malade, fiévreux, le personnage ne se met
pas à interpréter son rêve ! Mais
à peine remis de sa frayeur, aussitôt il se trouve « repris »,
« possédé » si l’on peut dire, par son unique hantise : « Seigneur, s’exclama-t-il, se peut-il, mais
se peut-il que je prenne une hache pour la frapper et lui fracasser le
crâne ? ».
Le narrateur ne s’appesantit pas non plus
sur le sens du rêve ; le roman appartient encore à l’innocente époque « d’avant la psychanalyse » !
Mais dans son économie générale, ce rêve est un déclencheur ; comme s’il
était venu à bout des dernières inhibitions du personnage et quelques pages à
peine le séparent à présent de son acte…
Cette importance des rêves est-elle
étonnante dans un roman où tout semble en trompe-l’œil, tremblotant, éclairé
par la lumière fragile des bougies, où les mêmes péripéties paraissent se
répéter, où les lieux (escaliers, ponts, appartements) sont des décors
interchangeables, obsessionnels, où l’on est pris de « vertige » – il n’existe sans doute
pas de roman plus « haletant », plus « oppressant » que Crime et châtiment –, où le personnage
principal peine à distinguer la réalité et les chimères de son esprit, se
demande sans cesse s’il « délire »
et dans ses errances se perd dans des rues où il ne se souviendra plus être
passé l’instant suivant, parmi des foules indistinctes de miséreux qui le
pressent, le bousculent, l’étouffent, où un autre (Svridigaïlov, son
« double » (3), son « Doppelgänger ») a des « apparitions » et reçoit sans s’en
étonner les visites de son épouse qu’il a peut-être assassinée, où tout d’un
mot semble à la fois réaliste et halluciné,
grotesque, comme dans un théâtre d’ombres ?
----------------------------------------------------------------------------------------
1 – Dans sa préface
à son roman Cosmos, Witold
Gombrowicz écrit : « Il y a quelque chose dans la
conscience qui en fait un piège pour elle-même. »
2 – Or, Raskolnikov
rêve de gloire. Son orgueilleuse interrogation pourrait être ainsi formulée :
« Comment, moi, Raskolnikov, puis-je être un Napoléon ? »
3 – Le thème du
« double » est par excellence le thème dostoïevskien. Voir l’un des
sommets de l’œuvre, Le Double, dont
il existe deux versions, l’une d’avant et l’une d’après le bagne ; ce
bagne où Dostoïevski a passé quatre années de sa vie et où, son crime avoué,
finit Raskolnikov.
Frédéric Perrot